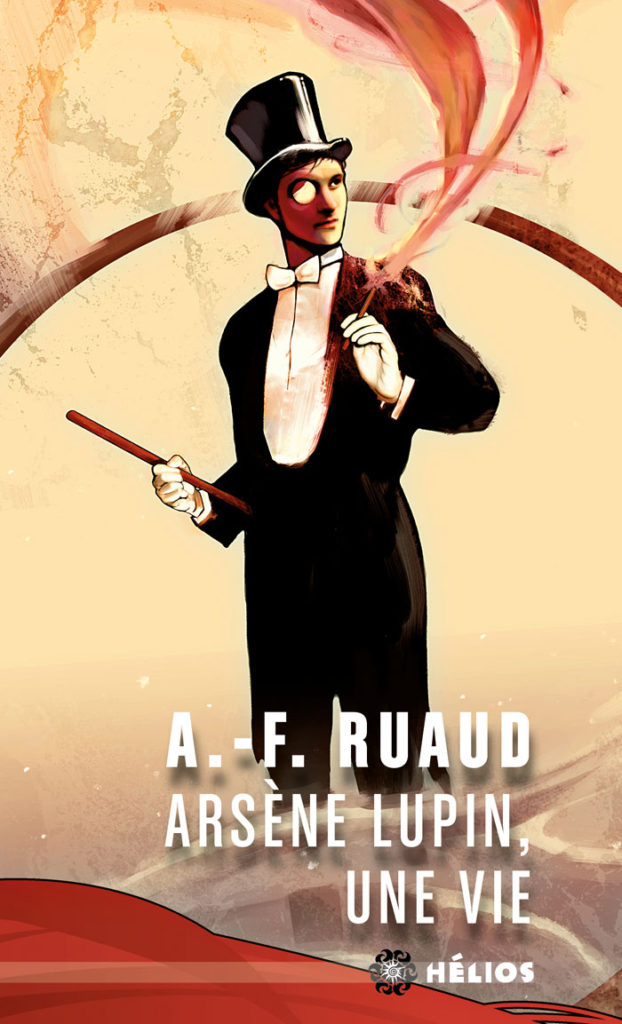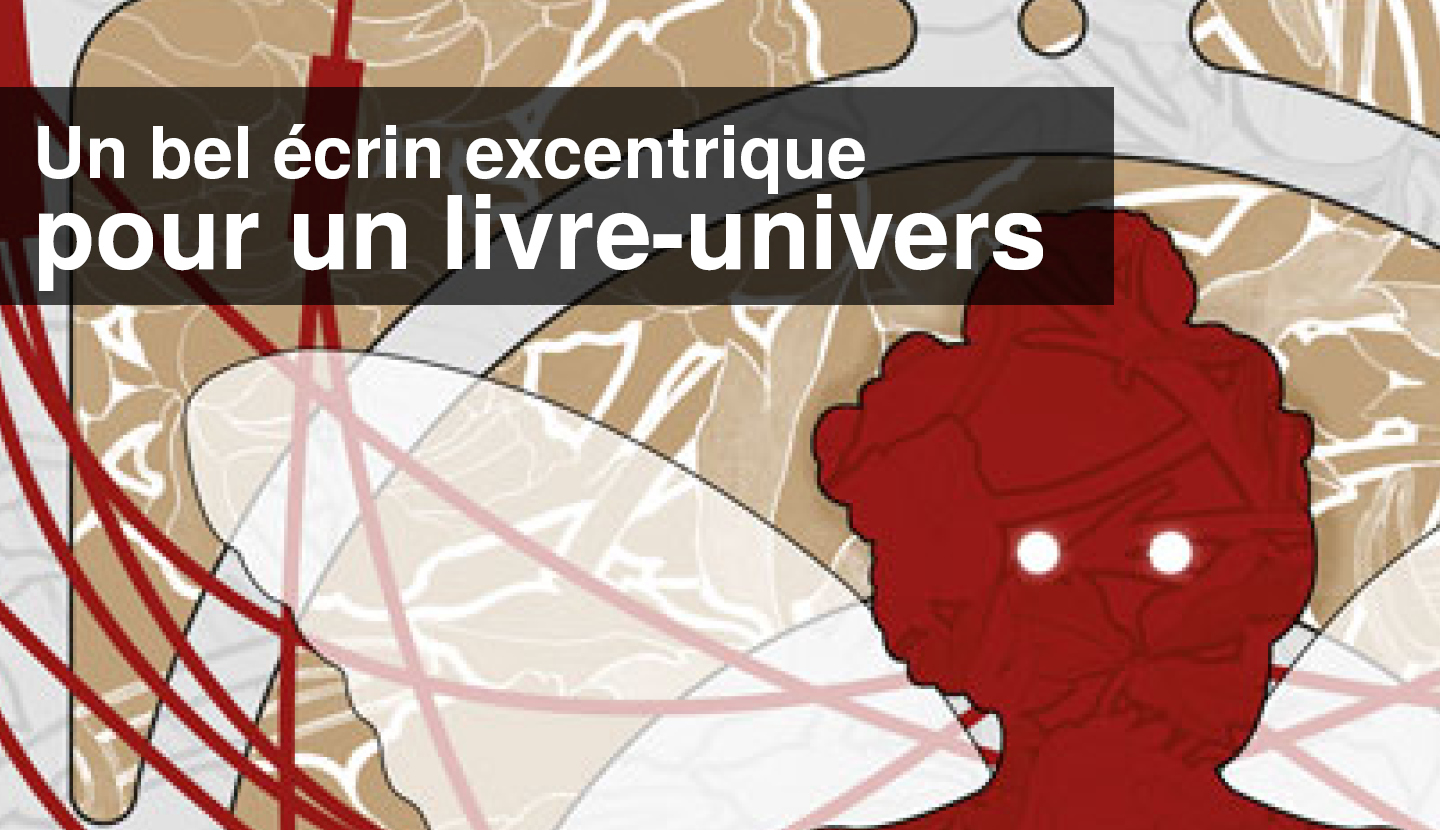Nous vous livrons régulièrement des « mots de l’éditeur » sur nos nouveautés, juste un petit texte à chaque fois afin de vous expliquer, de manière très personnelle, comme en confidence, l’origine d’un livre… Cette fois, André-François Ruaud vous parle d’une nouvelle collection exceptionnelle : « Les Saisons de l’étrange », au financement de laquelle vous pouvez participer ici: https://fr.ulule.com/les-saisons-de-letrange/
***
Le savez-vous ? Quelque chose de neuf et d’important est en train de naître : un nouveau label en imaginaire, les Saisons de l’étrange.
En tant que lecteur, il se trouve que depuis quelques années je fais une forte consommation de ce nouveau surnaturel qui est si florissant, toutes ces histoires de détectives de l’étrange, tous ces mélanges de polar, de thriller ou d’espionnage avec de l’uchronie, des fantômes ou de la magie ; tenez par exemple les Daniel O’Malley (en français chez Pocket), ou bien ceux que je viens juste de finir, des romans de George Mann, Lisa Tuttle et Vivian Shaw. En tant que consommateur culturel, je suis également fan de séries, forcément, et gros lecteurs de comics, aussi. Mais en tant qu’éditeur, c’est plutôt la création francophone qui m’anime, qui me passionne. Alors des idées sont nées, tout d’abord au sein de l’équipe des Moutons électriques, et puis par un effet inédit tout un projet a fait tache d’huile… les Saisons de l’étrange sont nées !
Un financement participatif (« crowdfunding ») a été lancé sur Ulule qui vise à la création de cette collection, qui va être co-éditée par les Moutons électriques. Les Saisons de l’étrange est un label co-dirigé par notre graphiste Melchior Ascaride, notre secrétaire, Vivian Amalric, et un bibliothécaire, Arthur Plissecamps, avec le soutien complet des Moutons électriques qui en avaient initié la mouvement. Financer cette campagne, c’est assurer la pérennité d’une telle entreprise : contrairement à la plupart des « crowdfundings », il ne s’agit pas en effet juste d’assurer l’existence d’un ouvrage ponctuel, mais bien de lancer tout un projet de longue haleine, très ambitieux et qui, très franchement, nous tiens tous énormément à cœur. Car au-delà de cette première saison, qui verra paraître de courts romans de Lazare Guillemot, Roland C. Wagner, François Peneaud, Olav Koulikov, Paul Féval et Cédric Ferrand, les Saisons de l’étrange ont vu loin, avec se bousculant pour les saisons suivantes des auteurs comme Jean-Philippe Depotte, Julien Heylbroeck, Nelly Chadour, Nicolas Le Breton, Brian Stableford, Sylvie Denis, Christine Luce, Irène Maubreuil, Brice Tarvel, Alex Nikolavitch, etc. Eh oui, ça rigole pas ! Ou plutôt si, justement, ça rigole : ce projet est fun, pulp, enthousiaste, et totalement dans l’air du temps… le surnaturel fait son grand retour dans le rayon de l’imaginaire, la sérialité est devenue une évidence, la forme courte aussi — la rapidité, les héros, les mystères, les monstres, les savants fous, les complots, les fantômes, les druides, les uchronies, le steampunk, le thriller fantastique… c’est tout ça qui est brassé dans ce projet fou.
Et si les donateurs savent déjà être certains d’obtenir la première saison, les libraires sont également assurés ainsi du lancement de cette nouvelle collection commercialement pertinente, porteuse, avec un investissement énorme : tournée de dédicace des auteurs, campagne de pub et de com (via l’agence Perfecto), articles dans la presse et sur les blogs, présentoir en carton pour les librairies, plaquette de présentation, affichettes et marque-pages… Jamais les Moutons électriques n’auront investi autant dans un lancement, soyons clair. Dire qu’on y croit serait l’euphémisme du siècle : c’est le projet qui nous… électrise le plus, en fait, une vraie source de bonheur éditorial. Alors allez-y, foncez, n’hésitez pas : soutenez !