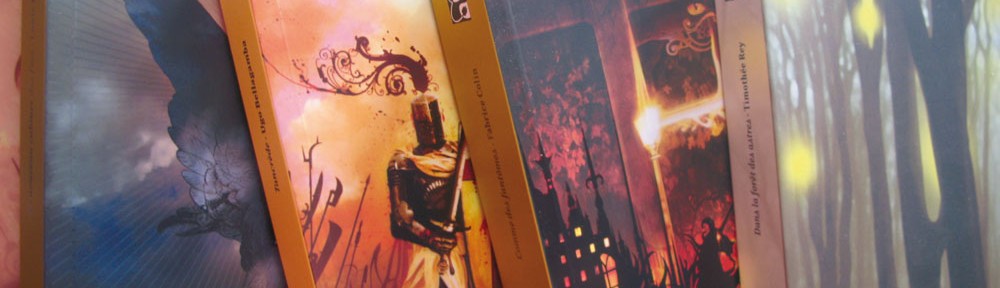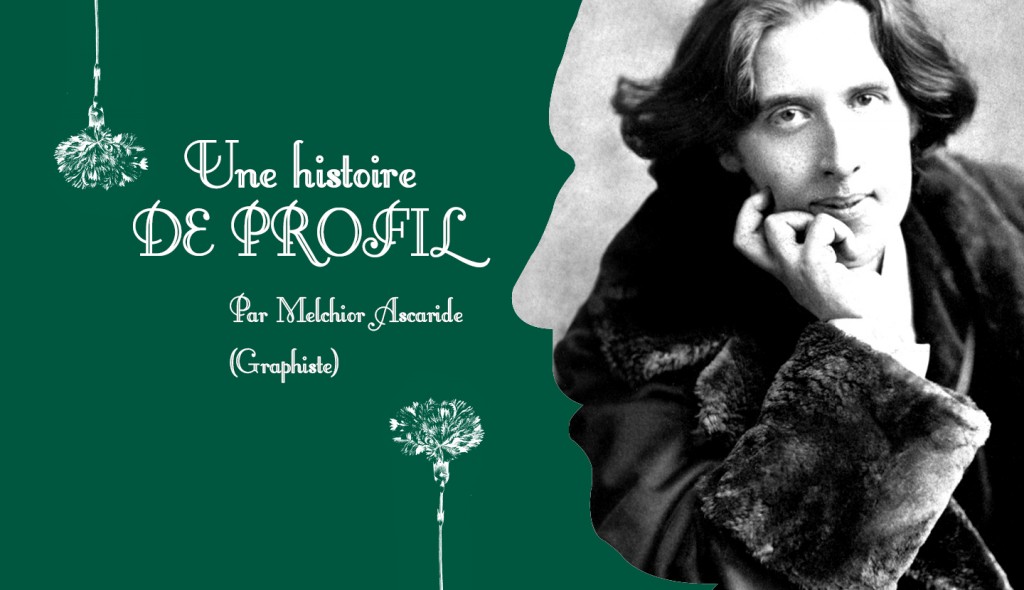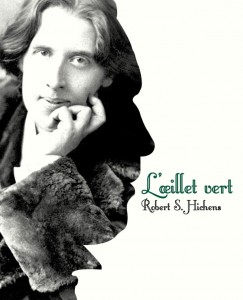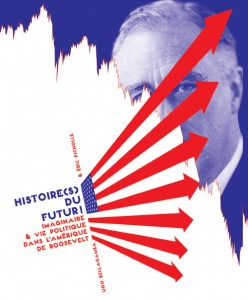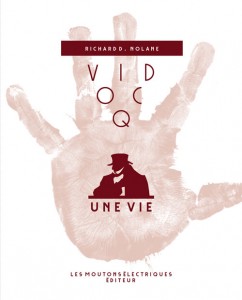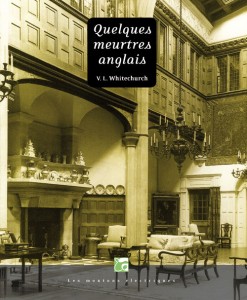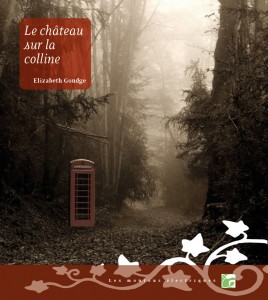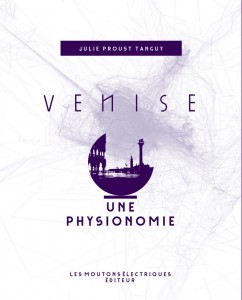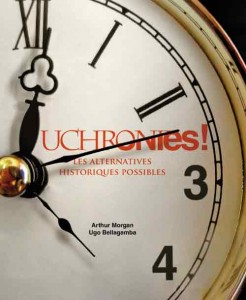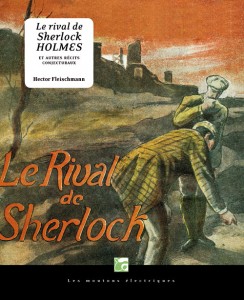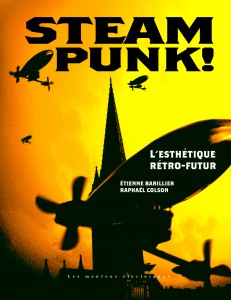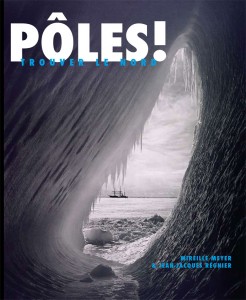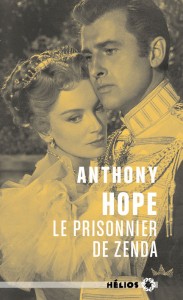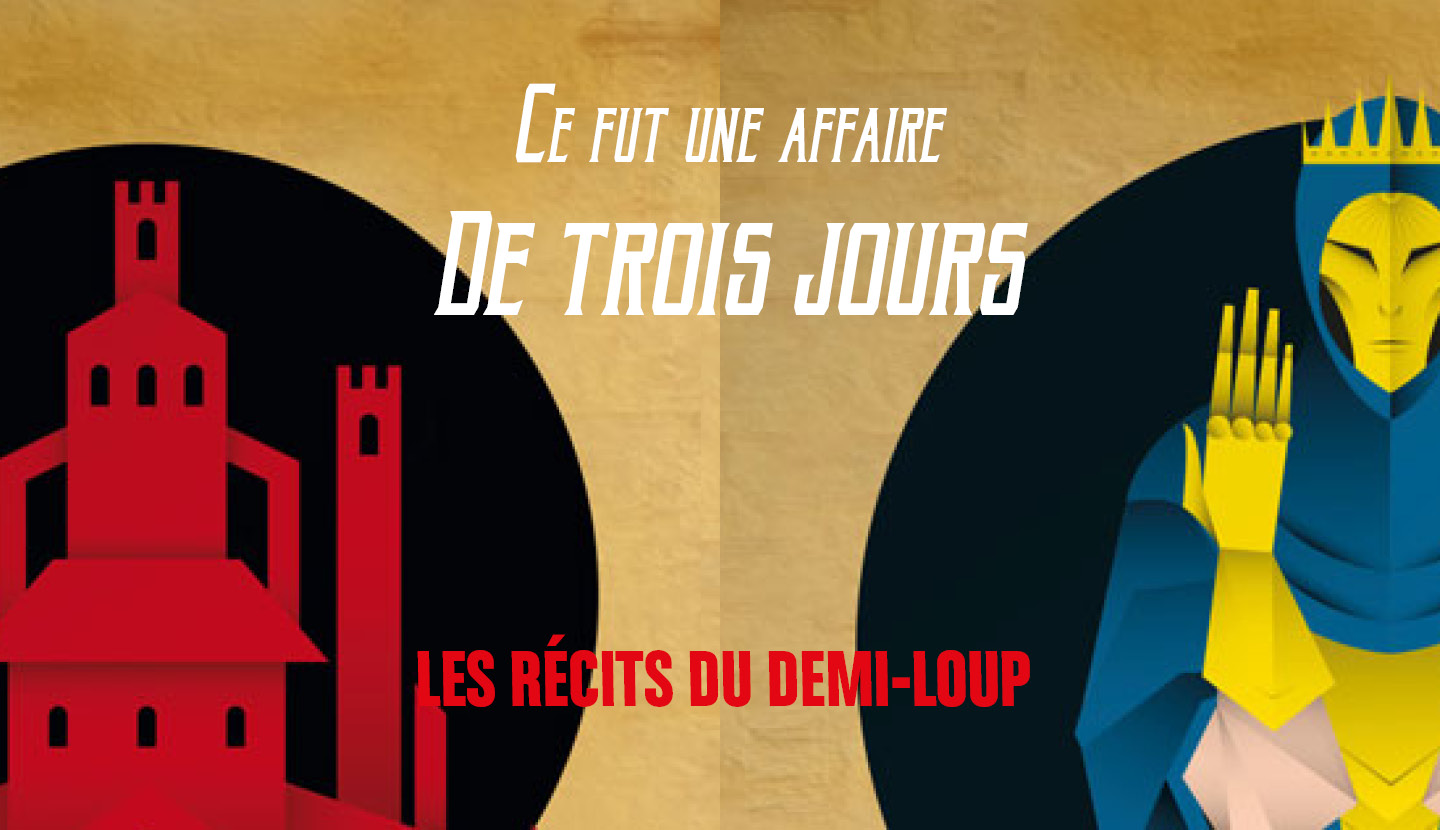 Nous vous livrons régulièrement des « mots de l’éditeur » sur nos nouveautés, juste un petit texte à chaque fois afin de vous expliquer, de manière très personnelle, comme en confidence, l’origine d’un livre… Cette fois-ci, Mérédith Debaque vous parle de la réception de la saga de Chloé Chevalier : « Les Récits du Demi-Loup ».
Nous vous livrons régulièrement des « mots de l’éditeur » sur nos nouveautés, juste un petit texte à chaque fois afin de vous expliquer, de manière très personnelle, comme en confidence, l’origine d’un livre… Cette fois-ci, Mérédith Debaque vous parle de la réception de la saga de Chloé Chevalier : « Les Récits du Demi-Loup ».
J’aime assez raconter la réception des manuscrits de Chloé Chevalier. Imaginez un peu, je commence à travailler, quelques livres à mettre en page sans doute, et là je vois cette appétissante pile de manuscrits érigée à ma droite. Lire les manuscrits est une expérience intéressante : l’impression de jouer à une sorte de loto littéraire. Il ne s’agit pas de juger de la qualité objective des ouvrages, mais plus d’estimer si l’un des manuscrits convient à la ligne éditoriale des Moutons électriques.
Ce jour-là donc, cette pile me fait de l’œil, et naturellement, abandonnant la quelconque besogne en cours (sans aucun doute essentielle au fonctionnement des Moutons électriques), je me jette dans la lecture des publications potentielles. Deux choses me marquent : premièrement, on y trouve le début d’une saga de fantasy (comme c’est original…), et deuxièmement, l’auteur se nomme « Chloé Chevalier ». L’ironie ne m’échappe pas, et je dois l’avouer, j’ouvre donc un peu rigolard le premier de la série.
72 heures plus tard, je me réveille dans mon fauteuil, plusieurs tasses de café vides à mes côtés, et trois manuscrits de fantasy imprimés éparpillés à côté de moi. Pris dans un maelstrom de lecture boulimique, j’ai dévoré les trois premiers tomes (NdÉ : en réalité, les deux premiers et demi, puisque le troisième n’était pas fini) en 3 jours. Stupéfaction et ravissement, je peux compter sur les doigts d’une main le nombre de bouquins qui m’ont causé pareil effet vampirisant (et une main à laquelle on aurait tranché, avec application espérons-le, plusieurs doigts).
Puis, après avoir informé le boss ovin de ma franche admiration pour la fantasy de Chloé Chevalier, et mon impérieuse envie de la voir au catalogue, une question vient titiller mon esprit embrouillé : pourquoi moi, un grand bonhomme d’une trentaine d’années, plutôt lecteur de romans concernant d’autres grands bonhommes (ou des grandes bonnes dames) matures et raisonnables, me suis-je laissé happer par le premier tome, Véridienne ? Il ne s’agit après tout que d’histoire de cinq fillettes, avec tout son attelage de disputes immatures, de bêtises enfantines et d’amourettes d’adolescentes… Pourquoi ai-je suivi ces enfantillages avec une passion vorace ? Facile, vous répons-je (après plus d’un an de réflexion) : Véridienne est une histoire de contrastes, le contraste entre les vanités de nos héroïnes et cette épidémie cruelle, la différence troublante entre leurs béguins naissants et les drames qui frappent leur entourage, leurs préoccupations puériles face à la menace constante de cet Empire mystérieux à l’immensité monstrueuse. Derrière leurs jeux, derrière leur rire, Chloé Chevalier tisse l’enjeu de sa saga. Nos protagonistes jouent, mais entre les cadavres de l’épidémie, elles aiment, mais entre les mensonges, elles rient, mais entre les tragédies passées et à venir… Rien d’étonnant à ce que ce premier tome m’ait happé tout entier pour me recracher plusieurs heures plus tard, heureux lecteur suppliant une suite.
Suite que j’avais sous la main, fort heureusement pour le salut de mon âme.
On dit (par on, j’entends le boss ovin) que les deuxièmes tomes sont souvent les plus faibles, parce que l’on n’y trouve ni exposition ni résolution, juste une continuité. Ce n’est pas le cas des Terres de l’Est. Si je devais le qualifier, ces quelques termes suffiraient : « Une promesse tenue ». Tout le potentiel dramatique que Chloé Chevalier cachait sous le voile déformant du regard des cinq jeunes filles, rejaillit ici avec force, au fur à mesure qu’elles grandissent et qu’elles constatent de leurs yeux plus lucides, moins innocents, l’état du royaume. Des caractères tracés encore en pointillés s’affirment, les secrets se révèlent. Indéniablement, Chloé Chevalier sait raconter des histoires. J’ai été étonné (et franchement admiratif), devant sa capacité à jouer avec la forme de son récit, un mélange, parfois savamment chaotique, d’épistolaire et de journaux intimes, pour créer une intrigue puissante. Derrière chaque ligne pèse un couperet, dont le balancement mortel annonce le destin qui attend nos cinq fillettes, destin qui ébranle déjà considérablement dans ce tome le Demi-Loup.
Ce fatal mouvement m’a captivé durant toute ma lecture. Ce fut une affaire de trois jours.
Mérédith Debaque, assistant éditorial des Moutons électriques
PS : Et non, je ne vous parlerai pas du troisième, il est trop tôt, et je n’en ai lu que la moitié, qui était fort bien d’ailleurs et… mais chut.
Vous aussi, découvrez le Demi-Loup : http://www.moutons-electriques.fr/livre-356 et http://www.moutons-electriques.fr/livre-410