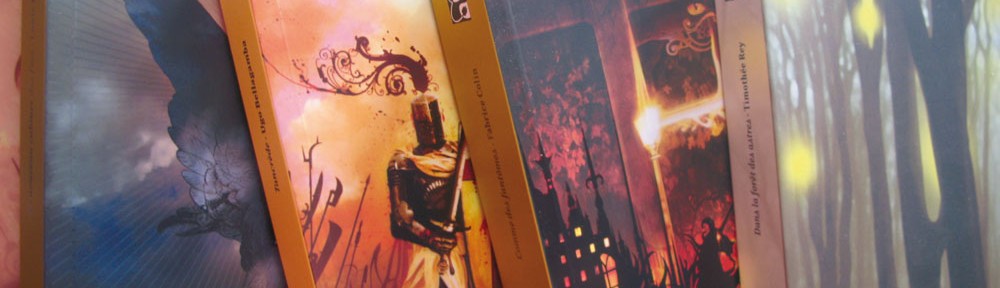Après avoir évoqué avec vous sa passion du genre littéraire « Nature Writing », André-François Ruaud est de retour pour vous parler d’un autre de ses domaines favoris : la psychogéographie. Qu’est-ce donc ? vous demandez-vous fort justement.
Eh bien, lisez, amis lecteurs, lisez.
***
Des poules d’eau et des canards, le vent ride la surface du canal que crible la pluie. Un joggeur passe, ahanant dans son portable. Les squelettes tout en courbes des anciens gazoducs se sont offerts une nouvelle jeunesse : la peinture vert et rouge met en valeur leur architecture élégante, qui se découpe nettement sur le ciel gris uniforme. Grondement lointain de la route, crépitement des gouttes sur mon parapluie, ruissellement de l’eau le long des murs, gazouillis d’oiseaux dans les buissons. Une foulque se met à criailler, on croirait entendre un klaxon — un cri singulièrement déplacé par rapport à la sobre tenue de clergyman du petit volatile, habit noir et bec blanc. La pointe du beffroi de St Pancras émerge au-dessus des arbres chenus, entre les gazoducs. Vers l’ouest résonne un carillon d’église.
Il paraît que Londres est la ville par excellence de la psychogéographie. De la quoi ? Eh, il faut sortir un peu : de la psychogéographie, vous dis-je. D’accord, un brin de définition serait sans doute nécessaire, alors convoquons un spécialiste, Merlin Coverley : « Les origines du terme ne sont pas trop obscures et peuvent être situées au Paris des années 1950 et aux lettristes, un mouvement annonciateur des situationnistes. Sous la direction de Guy Debord, la psychogéographie devint un outil pour tenter de transformer la vie urbaine, tout d’abord pour des raisons esthétiques puis plus tard avec des visées de plus en plus politiques. » [1] Ainsi donc si Londres en est une capitale, Paris se trouve tout de même à l’origine de cette discipline – poétique – esthétique, choisissez les termes qui vous conviendront le mieux.
St Pancras Lock : bruit de chute d’eau — l’écluse. Toujours des joggeurs. La tonalité d’appel de la gare résonne jusqu’au bord de l’eau. Étonnant Canal du Régent, qui dans les environs hésite constamment entre un charme désuet de cottage, une laideur de décharge, l’abandon d’une friche industrielle et la grâce multicolore des péniches. Passe un train de marchandises, vert et jaune acide, qui klaxonne gaiement. Juste après St Pancras Lock, des hangars en bois, blancs, au ras de l’eau, auxquels je n’avais jamais prêté attention auparavant : ce sont des ateliers de réparation de péniches ; l’un d’entre eux est ouvert, bruits de voix, de scie et d’eau. Sous le pont ferroviaire achève de rouiller une grosse barge en métal, qui sert de véritable décharge flottante : branchages, caddies, panneaux de circulation routière…
Cherchons tout de même une autre définition, tiens chez un Anglais, puisque ce mot de psychogéographie, après avoir été créé en France, a été si bien adopté par les marcheurs d’outre-Manche : « Psychogéographie : un guide pour débutant. Dépliez un plan des rues de Londres, placez un verre, renversé, n’importe où sur la carte, et tracez un cercle sur son bord. Prenez le plan, sortez en ville et marchez le long du cercle, en restant le plus près possible de sa circonférence. Tout en la vivant, enregistrez cette expérience, sur les supports ayant votre préférence : film, photographie, manuscrit, enregistrement audio. Saisissez le fil de la plume textuel de la rue ; les graffitis, les déchets de marques, les bribes de conversation. Coupez pour dégager les signes. Enregistrez le flot de données. Soyez attentifs au passage des métaphores, cherchez les rythmes visuels, les coïncidences, les analogies, les ressemblances de famille, les changements d’humeur de la rue. Bouclez le cercle, et l’enregistrement se termine. Marcher crée le contenu ; les pas font le reste. » [2] Voilà toute l’affaire, donc : la psychogéographie c’est tout l’art de savoir se perdre dans une ville, de la découvrir au ras du bitume, de transformer la marche urbaine en une façon d’explorer et de rêver, tout à la fois.
Ça ruisselle, ça ruisselle, j’ai l’impression de pénétrer à l’intérieur d’une fontaine. Les nombreuses chutes d’eau, le vert sombre du canal, les nuances de brun, rouille, glauque, paille, brique, la végétation rousse par endroits et verte par d’autres, les rivets gris clair du pont, les mousses sombres, les entretoises noires, les murs en brique d’un violet profond ou d’un carmin léger, brusquement tout est une délicieuse symphonie de couleurs. Il y a pourtant quelques papiers gras, des sacs en plastique, mais je ne les vois pas, ne les ai pas vus. Plus loin, un pont neuf sur de vieilles piles en pierre. Le canal s’élargit au-delà, s’éclaircit, devient le domaine des bureaux modernes et des entrepôts post-modernes. La cloche d’une église continue de résonner, lancinante. Le lierre et les buddleias rivalisent serré pour occuper le mur. De l’autre côté du canal, derrière une rangée de bâtiments modernes bas, en plastique moulé gris, beige, gris, vert fluo, gris, toute une flottille de camionnettes s’agglutinent dans une vaste cour — telles d’énormes hannetons rouge vif.
Mais pourquoi Londres serait-elle la ville par excellence de la psychogéographie, me redemanderez-vous ? Le phénomène a de quoi étonner, il est vrai : classiquement, les grands textes du domaine déambulaient plutôt dans Paris, que l’on pense aux surréalistes (Nadja de Breton, Le Paysan de Paris d’Aragon), aux « clochards volontaires » des années 1950 (Jean-Paul Clébert, Bob Giraud, Jacques Yonnet), ou bien encore à certains grands noms de la littérature française récente (le poète Jacques Réda, le romancier Patrick Modiano)… Alors quoi, quel basculement entra donc en œuvre, quelle attraction Londres se mit-elle à exercer au juste ?
Sous un petit pont en métal noir décoré de motifs géométriques blancs : roucoulements des pigeons abrités sous les entretoises, claquements des ailes. Le paysage évolue encore, la ville se rapproche, domine directement le canal : rouge, rouge, la brique des façades, noirs les troncs dénudés. Au-delà d’un petit pont si bas, si voûté, qu’il faut se pencher pour le passer, une rangée de taudis au ras de l’eau a été rasée ; des terraces traditionnelles exhibent leurs fenêtres surprises de contempler le canal après tant d’années. Encore une cloche d’église, tout près. Trois canards bavards et circonspects. Kentish Town Road Lock : juste au-dessus, cet étrange bâtiment à la « Humpty-Dumpty » — chaque élévation de son toit est dominée par un œuf fièrement posé dans un coquetier. Détail cocasse non prévu par l’architecte, Terry Farrell : des mouettes couronnent les œufs à intervalles réguliers. Il avait érigé tout cela pour une chaîne de télévision pour enfants, qui depuis a fait faillite. Mais voici Hawley Lock, brique noire, puis Camden Lock. Le marché bruisse et gronde de l’autre côté d’une haute palissade multicolore.
Remarquez, il y a toujours eu une certaine littérature psychogéographique londonienne, en concurrence avec celle de Paris : dans son guide, Merlin Coverley convoque par exemple Arthur Machen (peut-être le premier auteur à fournir un véritable modèle d’errance urbaine, lui qui savait dénicher le moindre détail insolite, dans sa Londres gothique), Robert Louis Stevenson dans L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, ou bien encore William Blake. Mais en définitive, un homme surtout transforma la psychogéographie aux dimensions et aux besoins de Londres : un certain Iain Sinclair. Référence obscure que celle-ci jusqu’à une date récente, mais par bonheur deux éditeurs l’ont un peu traduit en français, ce Sinclair : référez-vous alors au mince Londres 2012 et autres dérives (Manuela Éditions, 2011) et au ventru London Orbital (chez Inculte, 2010).
Au-delà du marché, le canal change encore d’aspect, se fait coquet et bourgeois avec l’arrière des terrasses chics. Les jardins descendent vers l’eau : saules, ponts d’accotement, tables de jardin… Des péniches s’alignent contre le canal way en une chenille colorée. Une bonne odeur de feu de bois flotte sur les lieux, émanant des cheminées des bateaux. Quelques mouettes passent dans le ciel en geignant. Et comment décrire le doux bonheur qui m’envahit à la vue de ce petit pont aux flancs partiellement couverts de lierre, que domine une haute maison sculptée dans le beurre frais. Passé le pont, une autre demeure à la haute façade d’un blanc-bleuté. Un balcon s’y accroche, délicatement ouvragé, couvert par l’arrondi excentrique d’une toiture en métal sombre. Le charme discret de la bourgeoisie, réinventé par l’architecte favori du prince Charles, Quinlan Terry. Car toutes ces belles demeures ne sont pas authentiquement anciennes : tout comme le front de Tamise de Richmond, plusieurs ne constituent en réalité que des sortes de pastiches architecturaux pour nostalgiques fortunés. Face à ces murs crémeux et aux palmiers fièrement dressés sur le grand ciel pluvieux, s’élève la petite église St Mark. Austère et ramassée, toute habillée d’une sévère pierre grise, elle pointe au-dessus du chemin, ne s’aperçoit que dans une trouée du feuillage.
Ce que pratique Iain Sinclair, depuis l’époque honnie des ravages thatchériens, c’est une forme de promenade décidée et hallucinée à la fois, un arpentage à longs pas de la métropole britannique avec en tête un immense mélange de paranoïa, d’imagination ésotérique et d’histoire locale. Il n’est pas un flâneur, plutôt un obsessionnel de la marche, un géographe psychotique qui, dans ses ouvrages, sait avec un talent formidable lier dans un seul torrent de mots ses digressions littéraires, ses connaissances pointues et ses hantises autobiographiques. Sinclair s’impose comme le modèle idéal de l’écrivain comme marcheur. Convaincant, influent, il a été suivi par bien d’autres Londoniens, au premier rang desquels Peter Ackroyd (auteur d’une monumentale biographie de Londres). La psychogéo londonienne est devenu domaine si prisé, si culte, qu’il pénètre maintenant même la littérature populaire : Mike Carey, Kate Griffin, Christopher Fowler (la série Bryant & May hélas non traduite) ou Ben Aaronovitch (trad. chez J’ai Lu) en font la matière de leurs séries entre polar et fantastique.
Le canal s’évase le temps d’un bras mort. La silhouette droite d’un héron me fait penser à un vieux gentleman : chevelure chenue et capeline grise jetée sur les épaules. Il semble couver d’un regard réprobateur les dorures extravagantes de la péniche-pagode (un restaurant chinois) qui s’élève le long de la rive haute. Arrêt d’un instant, pour une simple émotion : la beauté d’un arbre penché au-dessus de l’eau, chacun de ses rameaux porteur d’une goutte étincelante. Prenant des allures d’estampe japonaise, il se découpe clairement sur un fond de pont ouvragé en métal noir et de quelques demeures sombres.
Si l’on recherche des raisons à ce domaine si déraisonnable, si erratique, qu’est la psychogéographie de Londres, sans doute faut-il évoquer à quel point cette ville est immense, bien plus grande que Paris. Songer aussi qu’elle ne fut jamais sujette aux massives planifications du Second Empire, qui transformèrent Paris en un territoire de perspective grandiose tandis que Londres demeurait dans son jus, évoluant non pas par coupes franches d’un Hausmann légiférant mais par amoncellement et hasards. En cela Paris s’avère rectiligne tandis que Londres sinue, hésite, bégaie, terrain chaotique et donc parfaitement propice à de continuelles découvertes. Un autre élément à évoquer : les squares, les parcs, les coulées vertes, tant et tant d’espaces semi-clandestins, semi-naturels, comme autant de jardins secrets. Londres possède à merveille l’art de la respiration, des évasions buissonnières. Encore : les friches industrielles, qu’à Paris Philippe Vasset alla chercher dans la banlieue (Un livre blanc, 2007) et qui, à Londres, subsistent encore par immenses zones (malgré l’aménagement des Docklands, malgré celui de la cité olympique).
Londres des marcheurs, Londres de l’exploration urbaine : Londres psychogéographique. Et qu’importe si ces souvenirs d’une attentive promenade le long du canal du Régent datent déjà de plusieurs années, si les lieux ont un peu changé, si les hannetons rouges sont désormais cachés par de nouveaux bâtiments et si le marché s’est transformé en une triste caricature de lui-même, Londres se réinvente sans cesse et l’on peut toujours y marcher, y découvrir, y explorer — une immensité urbaine qui semble se jouer des règles ordinaires de l’écoulement du temps, tout se chevauche, sous le ciel tumultueux.
[1] Merlin Coverley, Psychogéographie ! Poétique de l’exploration urbaine, Les Moutons électriques, 2011.
[2] Robert McFarlane, « A Road of One’s Own », in Times Litterary Supplement du 7 octobre 2005.