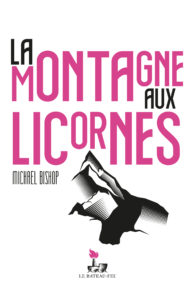Quelques mots comme une lettre,
au futur lecteur de La Famille de l’Hiver et le Roi-fée
Où l’autrice, Élisabeth Ebory, nous parle de son roman de la rentrée…
Avec la rentrée, le temps est venu de partager avec vous l’histoire de la Famille de l’Hiver, et du roi-fée. Comment vous présenter ces quelque 450 pages ? Je devrais y arriver, les ayant réfléchies, écrites et ré-écrites pendant cinq ans. Pourtant, à l’heure de la synthèse, il est plus difficile de démarrer que je ne l’aurais cru. Parfois, à l’aboutissement d’un long périple donne le vertige au voyageur fatigué, mais heureux. Les jalons de son parcours semblent lui échapper et se dissimulent dans un nouveau silence. Pour chasser cette aphonie soudaine, commençons simplement. Que nous conte ce roman ? Une initiation, une quête d’amour et d’amitié, des destins croisés et des entrelacs de décisions risquées, voire terriblement inconséquentes, qui mettront au bord du gouffre un peuple tout entier. Pour embarquer dans cette aventure, nous suivons Orégane et Marcus, amis à la vie à la mort. Dans la région de Cambridge, en 1910, tous deux mènent une vie dissolue – selon leurs contemporains. La demoiselle de bonne famille héberge un homme du commun, ancien balayeur, les colocataires partagent le même lit, et, autour d’un thé, au lieu de commenter le temps frais de la saison, ils évoquent des mœurs vicieuses que la morale condamne. L’Angleterre edwardienne n’est pas prête pour ces deux-là. Malgré leurs caractères bien trempés et leur tempérament batailleur, tous deux aspirent à s’évader de ce monde intolérant, truffé de juges mesquins, agressifs ou violents. De son côté, Orégane veut retrouver ses racines et son peuple. Quant à Marcus, il désire plus que tout rencontrer l’homme qui hante ses rêves et le sauve nuit après nuit – comment faire, quand sa mémoire nimbe de flou ce héros ? Orégane en est certaine : seule la magie des fées pourra l’y aider. Ainsi, leurs espoirs se tournent vers une autre terre, mais au lieu de choisir l’Amérique comme El Dorado, les deux compagnons préfèrent émigrer vers le royaume des fées, le Sidh. Mais souvent, les contrées fantasmées ne s’apprivoisent que difficilement. Les exilés se heurtent ainsi à une employeuse exigeante, un élève insolent, et une maisonnée méfiante. Pire encore, leur nouveau lieu de villégiature s’agite de remous mystérieux, provoqués par des spectres colériques, un homme politique douteux et un inconnu chargé d’étoiles. Petit à petit, pourtant, les deux anonymes se découvrent une famille magique et leurs destins s’entremêlent à celui de leur terre d’accueil.
Motivations, engagement, et cheminement
Vous connaissez maintenant la trajectoire du récit. Bien sûr, beaucoup de questions demeurent. Entre autres : quelle volonté animait l’auteur ? Un besoin d’aventure et de fantasy urbaine ? Très bien ! Mais pourquoi diable nous emmener à la suite d’un homosexuel trentenaire en 1910 alors que nous attaquons la rentrée 2022 ? La raison tient en une phrase : « parce que j’en avais terriblement envie », mais pour rester sincère, je m’explique un peu plus. Le cheminement de ce livre s’étend sur cinq ans d’écriture, ses personnages m’accompagnent depuis plus longtemps encore, et, avec eux, après m’être interrogée sur mille et un aspects de la littérature, sur les messages et les représentations que je désirais offrir, sur le désespoir et le rêve, sur le sens de la vie et sur la pertinence de la réponse 42 (cf. « Le guide du voyageur galactique »), j’ai voulu rendre hommage à une œuvre qui m’a marquée positivement, de toutes les façons possibles. Il s’agit de « Maurice », livre d’E.M. Forster et film porté sur grand écran par James Ivory en 1987. Personnellement, j’ai découvert cette histoire sur un minuscule rectangle cathodique par une belle nuit d’été, en 1998. J’ai lu le livre bien plus tard. Sur la quatrième de couverture de l’édition de poche, on apprend que ce roman a été écrit en 1914, et n’a été publié qu’en 1971. Pourquoi ? Parce que l’auteur est mort en 1970. Parce que l’homosexualité était pénalisée en Angleterre jusqu’en 1967. Parce que ce texte nous raconte les amours de Maurice, Clive et Alec. Et pendant quelque soixante ans, ces histoires sont restées muselées. Sincèrement, j’espère que, quelque part, E.M Forster sait à quel point son œuvre compte pour la communauté LGBT, mais la tristesse de ce silence imposé tord aujourd’hui encore mon cœur. En attendant, de mon côté du miroir, l’objet cinématographique m’a si bien impressionné quand je l’ai découvert que j’ai longtemps redouté de lire le roman éponyme. Et si j’étais déçue ? J’ai affronté ce terrible risque pendant la rédaction de la Famille de l’hiver et le Roi-fée. Après bien des tempêtes, mon texte naviguait enfin dans des eaux sereines. À travers les tumultes que le récit avait traversés, un seul élément demeurait toujours identique : Marcus rêvait et dans son rêve, quelqu’un l’aimait. C’était sa quintessence, et celle de l’histoire avec laquelle j’avançais. Alors, quand je suis tombé sur le passage suivant dans le roman d’E.M. Forster, j’ai pleuré. Une larme d’apaisement, une larme de reconnaissance, une larme de communion. Je vous cite les lignes qui m’ont émue : « Son deuxième rêve est plus difficile à rapporter. Il ne s’y passait rien. Il entrevoyait vaguement un visage, il entendait vaguement une voix lui disant “Voici ton ami”, et il se réveilla ébloui et éperdu de tendresse. Il aurait pu mourir pour un tel ami, il aurait accepté que son ami meure pour lui ». Je trouvais un écho si puissant là où je craignais la déception, d’un rêve isolé, une espérance commune jaillissait, universelle et farouche. L’envie d’être aimé, le besoin d’aimer, la main tendue, l’ami recherché – avec toutes les déclinaisons possibles de ce terme… Ces quelques phrases resteront un formidable bonheur littéraire pour moi, et je me suis sentie plus déterminée encore à vous conter cette histoire. Car nous méritons tous que ce rêve devienne réel. Mon attachement à cette œuvre prenait tout son sens, et avec lui, je voulais aussi rendre hommage aux luttes de la communauté LGBT, en particulier celles qui ont traversé le XXe siècle pour nous permettre dorénavant de hurler, crier, chuchoter, fièrement ou pas selon les jours, que nos identités existent. Qu’elles ont leur place dans notre monde et qu’elles sont valides. Qu’elles n’ont pas à se soumettre à un quelconque jugement. Que ce soit il y a plus d’une centaine d’années ou à l’ère du réchauffement climatique, que soit en emménageant avec son compagnon ou sa compagne, ou en déchaînant des émeutes nécessaires, j’admire ceux qui combattent au jour le jour. Grâce à chaque implication unitaire, les consciences s’éveillent, la société évolue, et les droits LGBT progressent – lentement, avec des coups d’arrêt, parfois en subissant des revers dramatiques, et il ne faut pas oublier que ces luttes, à l’instar du féminisme, mérite d’être perpétué, embrassé et célébré pour entériner la liberté de chacun à disposer de son corps, de ses sentiments et de sa vie, dans un cadre parfaitement consenti.
De mon côté, en tant qu’individu lambda qui a du mal à s’accorder le privilège d’une identité (trauma quand tu nous tiens), je ne sais pas quoi apporter à la communauté queer. En revanche, en tant qu’auteur, je sais. J’ai compris très tôt qu’à travers ce que j’écrivais, je pouvais simplifier les équations compliquées qui perturbaient certains de mes camarades, perplexes ou carrément fermés devant l’homosexualité masculine ou féminine. Mes mots leur permettaient de comprendre qu’il ne s’agissait là que d’amour et de rien d’autre. Aujourd’hui, à sa mesure, la Famille de l’hiver et le roi-fée participe à cet engagement personnel, et je suis heureuse de vous présenter Marcus. Enfin, pour mieux appréhender le début de son parcours, j’apporterai une précision au sujet des droits LGBT. En 1910 et en Angleterre, la loi ne punit plus de peine de mort les relations sexuelles entre hommes, mais ces dernières restent passibles de peines de prison. Le cas le plus célèbre de l’époque : Oscar Wilde, dont le procès en 1895 se solde par une condamnation de 2 ans de travaux forcés. En 2020, l’homosexualité est toujours punie de la peine de mort dans 12 pays dans le monde, et réprimée dans 60 états sur les 193 reconnus par l’ONU.
Les femmes de la famille
Avec Marcus, Orégane, l’apprentie-sorcière en quête d’un peuple et d’une famille porte la question du métissage culturel. Fée élevée parmi les hommes par un grand-père odieux, elle a été rabaissée toute sa vie et considérée comme moins que rien. Malgré toutes les épreuves qu’elle a déjà traversées, il lui reste à franchir un dernier barrage avant de pouvoir s’accepter. Il devra lire le testament de son tuteur, cet ange maléfique qui l’a plongé dans les tourments de la mort, de la douleur, et du mépris. Avec elle, j’avais envie d’explorer cet aspect très personnel du métissage et de la perte de racine – il ne s’agit même pas de déracinement, juste d’un oubli, d’un déni, un état de fait. Vous êtes métisse, mais une partie de vous n’est tout simplement pas là, et il faut avancer avec ça. La plupart du temps, le flot de la vie emporte ces questions, mais un jour, l’eau de votre fleuve tranquille s’évapore sous une sécheresse ardente. Les berges et le lit mis à nu ne correspondent pas à ceux que vous attendiez, vous rêviez d’un paysage paisible d’ajonc et de roseaux, de quelques flaques où surnage le soleil, et vous découvrez des branchages arrachés, des épaves, et des trésors insoupçonnés… Appréhender ce paysage inconnu demande du temps et ainsi, navigant entre déception et questionnement, intolérance et prise de pouvoir, Orégane chemine au fil des pages, aux côtés de Marcus. Car oui, elle a soif de compagnie – et la réciproque est vraie, Marcus serait perdu sans elle. Héroïne en devenir, Orégane a besoin des mauvaises blagues de son meilleur ami, de sa présence à ses côtés pour chasser les cauchemars, et de son soutien pour entreprendre son voyage vers elle-même. Derrière cette relation qui irrigue le roman se cache ma découverte effarée d’une entrée Wikipedia. Croyez-le ou non, il existe une page pour l’expression « fille à pédé ». Et à sa lecture, j’ai eu terriblement envie de dynamiter cette vieille idée reçue et toute la condescendance qui l’accompagnait. Je voulais une amitié plus forte que la mort, plus intense que le sexe, et surtout, réconfortante comme un heureux souvenir d’enfance. Cette union platonique, apaisante et électrique, devait pulvériser la mascarade que les mauvais esprits aiment imaginer. Ce lien indéfectible entre Orégane et Marcus guide le roman, et impressionne même les plus puissants des fées. J’espère que vous aurez plaisir à le découvrir.
Si Orégane et Marcus ont besoin l’un de l’autre, ils ont aussi viscéralement besoin d’une tribu, comme à peu près tous les personnages de cette histoire. Certains construisent leur fratrie de toute pièce, d’autres prennent un peuple en otage pour se sentir entourés. Tous, à leur manière, il cherche un clan, où chacun respecte les spécificités, les désirs, et les rêves de tous. C’est ce qu’offre la famille de l’hiver. Pour la rencontrer, il faut franchir le seuil d’une grande villa, perdue au fond des bois comme un souvenir oublié. La grille du jardin s’ouvrira devant vous dans un grincement, vous serez accueillis par des sourires curieux ou des grognements ronchons, mais ne prenez pas peur. Même s’il parait qu’on se perd facilement dans le grenier, personne ne vous abandonnera. Dans le salon ou près du poêle, à la cuisine ou dans les chambres, vous croiserez nos deux Anglais exilés, mais aussi les hommes politiques douteux, les sorcières reconverties, et les bandits enchanteurs. Mais avant tout, c’est une mère de famille célibataire, investie dans le renouveau du monde fée et surchargée de travail qui vous accueillera. Souvent, on lit que l’archétype de la « mère » représente l’ultime cliché de la femme, une sorte d’épouvantail à bannir au profit des guerrières. Et en effet, la vision patriarcale de la maternité n’a rien de merveilleux. Mais si nous n’opposons rien à cette caricature, comment progresser ? Alors, dans ce roman, un des personnages principaux est une femme qui a voulu enfanter et qui en a le droit, comme d’autres femmes, qui ne désirent pas devenir mères, en ont tout autant le droit. Une femme sans homme. Une femme avec des employés, une carrière, des projets pour rendre le monde meilleur, et l’envie de léguer à ses gamins une société libérée de ses blessures. Ce personnage s’appelle simplement Madame. C’est un surnom pratique, passe-partout. In real life, elle signerait ses SMS d’un « la maman de Joseph et de Frantz », coupant l’un ou l’autre des prénoms en fonction de son interlocuteur. Avec un peu de chance, ses correspondants finiraient par se souvenir de son identité, et par comprendre qu’elle existe bel et bien en dehors de ses enfants. Au jour le jour, c’est parfois compliqué. Et pour contrer ces difficultés quotidiennes, pour donner une autre vision de ce cliché maternel, j’avais envie de puiser dans la force de caractère et la détermination féminine. Le peuple fée navigue des eaux troublées, jusqu’à dériver parmi des récifs terrifiants, et il a cruellement besoin d’un guide droit et honnête. Flanquée de ses deux fils, la matriarche conduit un navire aux roulis incertains. De nombreuses femmes l’accompagnent dans cette tâche : capitaines des armées, dignitaires avares, sorcières-médecins… Valeureuses, téméraires et intelligentes, toutes se sont affranchies de leur carcan, de leur blessure, et aucune limite ne saurait les retenir.
Et la fantasy dans tout ça ?
C’est en lisant une interview d’Ellen Kushner lors de la réédition de « À la pointe de l’épée » que l’intérêt de la fantasy en matière de construction sociale a fini de me convaincre. Pourquoi recréer sans cesse des univers qui nous aliènent d’une façon ou d’une autre ? Et effectivement, quel plaisir de tirer un trait sur les préjugés, les ordres moraux et toutes les hypocrisies qui nous malmènent. Dans le monde des fées, au lieu de se soucier des rumeurs et de craindre des agressions, Marcus se construit, tout simplement. Il n’en demeure pas moins homosexuel, son passé, ses questionnements ne disparaissent pas comme par magie, mais il respire, et grâce à cela, il se rapproche de son rêve. De même, la primesautière Orégane n’est plus jugée à l’aune de ses amitiés ou menacée par les idées reçues de quelques brutes. Bien au contraire, elle peut révéler l’entièreté de son pouvoir et devenir ce qu’elle veut être : une érudite, férue de culture magique, empathique, généreuse et intrépide. Voilà ce que permet le terrain de la fantasy. Mais, quid de la population du Sidh ? Qu’apportent les fées, à l’exception de leur foule chamarrée et de leur cortège de coutumes ? Eh bien, il faut bien le reconnaître, elles restent discrètes dans le roman. Ou peut-être, l’ombre imposante du sauveur du Sidh les dissimule-t-elle ? Parmi le petit peuple, un homme s’érige haut sur l’horizon. C’est un insupportable histrion, suffisant et monomaniaque, désordonné et autoritaire. Chers lecteurs, je vous présente le roi-fée. Ni élu ni désigné par dieu, traçant sa propre légende à la force de sa plume, Sean LeavesOfAlder, ancien alcoolique et nouveau sauveur, siège dans le palais de la capitale fée et vous souhaite la bienvenue au cœur de son royaume, en toute simplicité.
Accumulant les ambitions bienveillantes et les mensonges, les mufleries et les principes douteux, ce faux roi tout en nuance de brouillard, irrigue la terre des fées de son énergie inextinguible et avec lui, le Sidh profite d’un équilibre précaire, après des siècles de ténèbres. Bien sûr, de son propre avis, il est le leader idéal, l’icône incontournable de son univers. Pourtant tout le monde ne partage pas son opinion, même à deux pas de son palais, des fées perspicaces ne lui accordent pas aveuglément leur confiance, et dans ses pas, la contestation s’élève et prend corps. Sa silhouette souple bondit de toit en toit, et parsème la nuit d’étoiles. Dans le sillage du roi-fée, vous apercevrez forcément ce scintillement lointain, un anonyme surnommé le marchand de sable. Autre incarnation de la magie et du merveilleux qui hante les pages du roman, ce personnage complète le roi-fée, facette lumineuse aux côtés d’un symbole de grisaille. Tous deux partagent un amour sincère pour le peuple brisé du Sidh, mais, impétueux et intransigeants, pourront-ils admettre leur point commun ? En tout cas, enchanteurs de haut vol, ils savent insuffler l’espoir et rassurer les plus rétives des créatures – qu’elles soient des fées bien survivantes ayant connu des jours trop sombres, ou des spectres dévorés par la colère, fauchés trop jeunes par des assassins implacables. Avec la liberté de la fantasy, le roman explore également les territoires de la mort, en traversant son infranchissable barrière, du deuil et de la mémoire, à travers ses Orégane et Marcus, et travers les blessures de l’histoire fée. Encore ouvertes, les plaies de tout un peuple regorgent d’une humeur rance, qui menace de déborder, sous les assauts de douleur, les âmes se tordent, s’emportent et se révoltent. Étouffés par les mensonges du roi-fée, ces fantômes risquent bien d’embraser le Sidh, jusqu’à réveiller les pires cauchemars du passé.
Je peinais à commencer cette présentation, et maintenant, je voudrais vous dresser une liste rapide des coutumes du Sidh ou évoquer avec vous les mondes que nous traverserons en quête d’un héros à aimer, ou les caractères flamboyants des rejetons fées, mais à ce stade, le roman vous les exposera mieux que moi. Je me contenterai d’un dernier souhait. Les trois parties de cette aventure composent une microscopique trilogie, avec des nuances et des accentuations différentes, des notes de parfum qui évoluent, des rythmes qui virevoltent, car j’avais envie de partager avec vous une histoire riche de ses détails, de vous inviter dans un voyage initiatique et mémoriel, et de vous offrir un agréable moment de lecture. Maintenant, comme dirait l’irrévérencieux roi-fée : profitez, l’hiver vient, et il a changé.