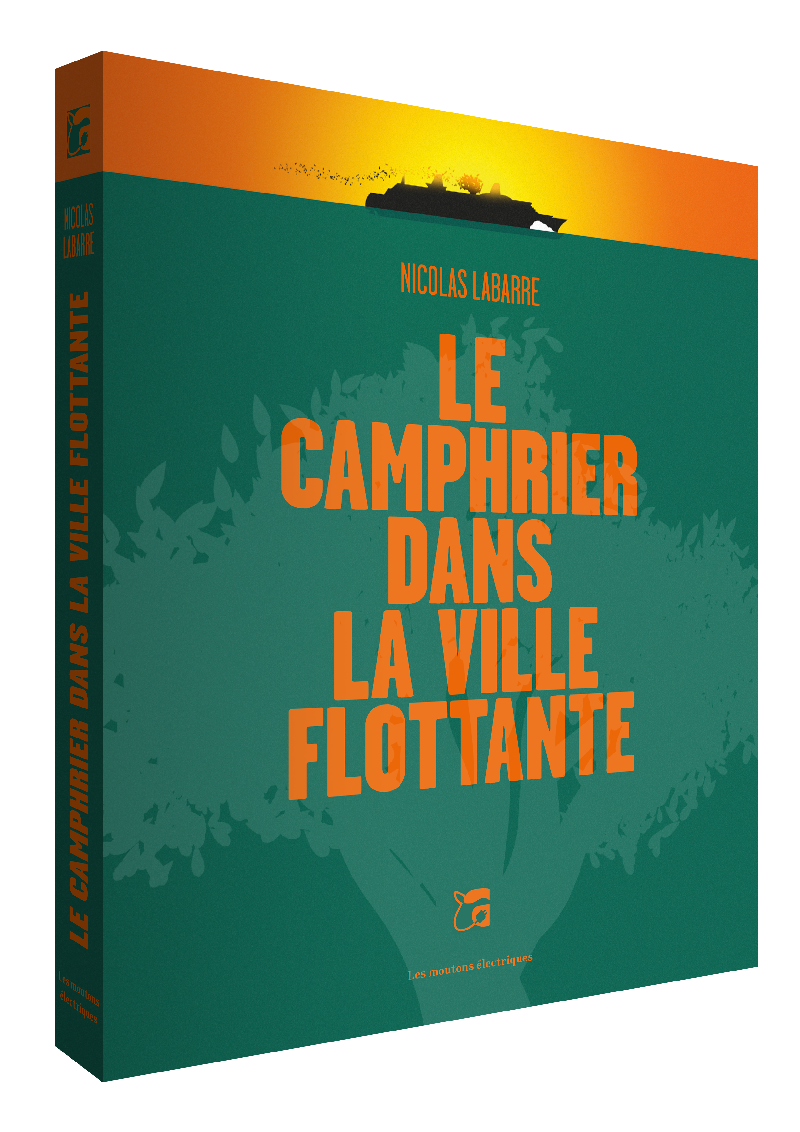Nous vous livrons régulièrement des « mots de l’éditeur » sur nos nouveautés, juste un petit texte à chaque fois afin de vous expliquer, de manière très personnelle, comme en confidence, l’origine d’un livre… Cette fois, Melchior Ascaride a eu envie de revenir sur des auteurs qui nous tiennent à cœur.

D’ordinaire pour les Moutons électriques je rédige, de temps en temps, un article pour vous parler de comment je conçois mes couvertures. Mais pas cette fois. Considérez que ce billet est une sorte de hors-série. Non, cette fois, je vais vous parler de deux auteurs dont j’admire le travail et que je considère comme importants. Et comme j’aime la parité, il y aura un homme et une femme.
Comme il n’y a nul ordre d’importance entre les deux, je vais faire simple et utiliser l’ordre chronologique. Enfin, l’ordre dans lequel je les ai découverts. Et je commencerai donc par Roland C. Wagner.
Les Moutons et moi, c’est une histoire qui a débuté en 2013. Le premier auteur sur lequel j’ai dû travailler était donc Roland (sans surprise, je vous ai tout spoilé il y a quelques lignes). Sauf qu’à l’époque, je ne connaissais pas son travail. Pour faire le mien dans de bonnes conditions, je me suis donc procuré non sans certaines difficultés quelques-uns de ses ouvrages. Je vais vous dire que j’ai été immédiatement conquis mais vous êtes malins et vous le savez déjà et de toute façon ce n’est pas le propos.
« Et quel est-il ton propos ? Parce que tu jactes sur le passé et comme toujours tu mets huit ans et demi à cracher ta pastille ! », vous exclamerez-vous. Et vous avez un peu raison. Mais c’est moi qui écris alors prière de ne pas intervenir et de garder vos questions pour la fin de la conférence. Mon propos est que Roland C. Wagner est un auteur majeur de l’imaginaire français pour plusieurs raisons. Je pourrais vous parler de pas mal de choses, de son univers (enfin, ses univers) ou de sa plume. Mais non, je voudrais aborder un sujet précis, deux romans à l’appui. Accrochez-vous et décompressez, j’entre dans le vif du sujet.
Pour moi, Roland C. Wagner est l’égal de Stephen King. Je m’explique. Bon en fait je vais parler de trois auteurs, pardon je n’ai pas fait de plan et du coup il y a un peu arnaque sur l’introduction. King, il a été toute une palanquée de textes qui se répartissent harmonieusement sur un éventail allant de l’infecte purge au chef-d’œuvre. Mais ses récits se rangeant dans cette dernière catégorie ont tous un point commun : ils sont des témoignages de l’époque de King. Des histoires rendues efficaces parce qu’elles parlent des États-Unis tels que lui les as connus. Pour faire simple, prenez Ça et Le Fléau. Outre leur formidable idée fantastique, on voyage dans l’espace et le temps, on voit ce pays par les yeux de l’auteur, à une époque particulière. C’est un vrai travail historique et sociologique que d’explorer ce que pouvait être les enfants, les adultes, les classes moyennes voire pauvres du Maine dans les années 1960. Eh bien, Roland Wagner a la même démarche.
Cela m’a particulièrement frappé à la lecture de deux de ses romans : La Saison de la sorcière (paru aux Moutons électriques fin 2017) et Le Nombril du monde (paru aux Saisons de l’étrange en avril 2018). Le premier se déroule à Cachan, dans la banlieue parisienne. Le second, à Clamart dans la même banlieue. Dans les deux, on y suit des personnages assez hétéroclites mais partageant leur statut de marginaux. Rien d’extrême, des petits délinquants, des loubards… Les lieux et personnages que R. C. Wagner connaissait et fréquentait. Lorsque j’ai lu Le Nombril du monde, j’avoue avoir à quelques instants ricané en entendant le personnage de Zidane parler. Le personnage du livre, pas le joueur de foot. En voyant son utilisation abusive du verlan, je me suis dit « C’est un peu too much, personne ne parle comme ça ! ». Sauf qu’à y repenser en vérité, si. Le roman se passe dans les années 1990 en banlieue parisienne. Je ne suis pas Parisien depuis très longtemps, mais j’ai côtoyé certaines personnes issues de ces milieux et de cette époque. Et ils parlent encore comme ça. Alors non, ce n’est pas too much, c’est en réalité très juste, très réel, même si ça prête à sourire aujourd’hui.
Et entre nous, des fois ça ne vous tape pas un peu sur les nerfs que toutes les œuvres d’imaginaire ancrées dans notre monde ne se déroulent qu’à Londres et New York ? Je n’ai rien contre ces villes, hein, la seconde je ne la connais même pas. Mais c’est un peu là le problème. Si je connais Londres et peux retrouver dans certains romans des lieux par lesquels je suis passé, New York je n’en ai qu’une vision biaisée due au cinéma. Pas Cachan. Pas Clamart. C’est littéralement derrière chez moi, je peux y aller à pieds. Pas pour un genre de pèlerinage, mais juste pour aller voir comment ça a changé. Comment on y parle aujourd’hui. Et me dire que grâce à Wagner, ces lieux désenchantés et peu enchanteurs sont en réalité imprégnés de magie.
Pour la seconde partie de cet article décidemment trop long mais qui me tient à cœur, j’aimerais vous parler d’une autrice venue des États-Unis, Lisa Goldstein.
Je vous passe comment je l’ai découverte, de la même manière que l’auteur précédent, vous connaissez la rengaine. Et tout comme Roland Wagner, il y a deux romans que je souhaiterais évoquer : Amaz et L’Ordre du labyrinthe (les deux sont disponibles chez Les Moutons électriques). Pourquoi Lisa Goldstein ? Parce que, comme Wagner mais néanmoins d’une autre manière, elle sait parfaitement imbriquer le réel dans ses récits imaginaires. Pour un résultat d’une crédibilité à toute épreuve.
Dans ces deux romans, on parle de magie et de magiciens. Mais avant tout, on parle d’êtres humains. Chez elle, pas de Prophétie De l’Élu Que Y A Que Lui Qui Peut Vaincre Le Grand Méchant. Ni d’élu. Ni de grand méchant. Personne ne veut détruire ou dominer le monde, ce qui entre nous est un plan d’une stupidité effarante. Si un jour quelqu’un clame vouloir conquérir le monde, magicien ou non, vous lui filez ses cachets et lui remettez sa chemise qui s’attache dans le dos. Moi j’ai décidé de devenir freelance parce que bosser tous les jours avec trois ou quatre autres personnes ça allait être compliqué, alors imaginez avec huit milliards d’autres.
Oui ça va je reviens au sujet principal.
Amaz, c’est l’histoire d’une famille (le père, la mère et les deux sœurs) qui partent s’installer dans la ville du même nom. Une ville où la magie est réelle et imbibe littéralement les rues. Une ville qui est presque un autre monde, mais dans le nôtre. Comme si on pouvait aller en avion de Paris à Minas Tirith. Dans L’Ordre du labyrinthe, c’est une jeune femme qui enquête sur sa famille qui pourrait bien avoir des liens avec un ordre occulte.
Tiens donc, deux histoires de famille. Alors j’en entends bien quelques-uns râler sous prétexte que ça fait cinéma français. Alors déjà non, puisqu’il y a des magiciens. Ensuite, ce n’est pas emmerdant pour deux sous puisque que ce ne sont pas des familles bourgeoises (et/ou racistes) qui s’écharpent autour d’un réfrigérateur. Ces deux romans me tiennent à cœur parce qu’ils tombent parfaitement sous la coupe d’un mot qui a tendance à se perdre : subtils. Subtils parce qu’ils abordent l’imaginaire sous un angle qui moi m’intéresse toujours : que se passerait-il avec des personnages parfaitement lambda ?
Je vous entends rouspéter au fond de la salle comme quoi « Ouiii, euh si on lit de l’imaginaire, c’est justement pour sortir du réel et ne pas avoir affaire avec des gens normaux. » Cela je l’entends. Mais pour vous montrer l’intérêt (ça fait super pédant et professoral, navré) de cette approche, je vais prendre l’exemple d’un personnage que l’on connaît tous et qui est pour beaucoup une véritable icône : Spider-Man. Pourquoi l’Homme Araignée est devenu l’un des super-héros les plus appréciés des lecteurs de comics ? Parce qu’au-delà de ses facultés surhumaines, Spider-Man c’est Peter Parker, un ado comme tant d’autres qui a des problèmes de famille, de fric, de cœur, d’estime de soi, de boulot etc. C’est le personnage qui répond au mieux à la question : « Comment vivrait vraiment Monsieur Tout-le-monde s’il devenait soudainement un surhomme ? ». Lisa Goldstein aborde la même question : « Que feraient véritablement des personnes tout à fait normales si elles étaient magiciennes ? ». Vous, moi, tout le monde, si on se trouvait soudain capable de plier la réalité à notre bon vouloir, est-ce qu’on ne ferait que des choses bien ? Comme les personnages de Lisa Goldstein, on a aussi notre part de mesquinerie, de jalousie, de rancœur, d’envie… toutes ces choses qui nous rendent profondément humains. Ses histoires parlent de personnes qui ne délaissent pas leur humanité, loin s’en faut, sous prétexte qu’elles disposent de capacités magiques. Et qui, malgré leurs grands pouvoirs (qui impliquent de grandes responsabilités, le fil rouge se tient), sont aussi capables de faire ce que l’on appelle communément « de la merde ». Je n’ai pas de frères ou de sœurs et j’ignore tout de la situation familiale de Lisa Goldstein, mais lorsque j’ai terminé ces deux romans, m’est revenue une citation de l’un des héros de mon enfance : « J’veux pas d’famille, j’veux aucune famille, la famille c’est chiant ! »
Une fois que vous aurez lu ces deux livres, vous serez peut-être enclins à dire que les personnages de Lisa Goldstein sont un peu plats. Et en un sens vous n’aurez pas tort. Mais avant de les lire, gardez dans un coin de votre tête que lesdits personnages ne sont pas plats. Ils sont normaux, humains. Vous les croisez tous les jours, vous en avez peut-être dans vos proches. Et lorsque vous vous demanderez ce que ferait telle ou telle de vos connaissances si elle était magicienne, vous verrez que, très certainement, vous tiendrez une figure goldsteinienne.